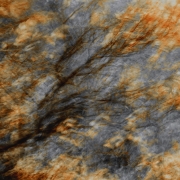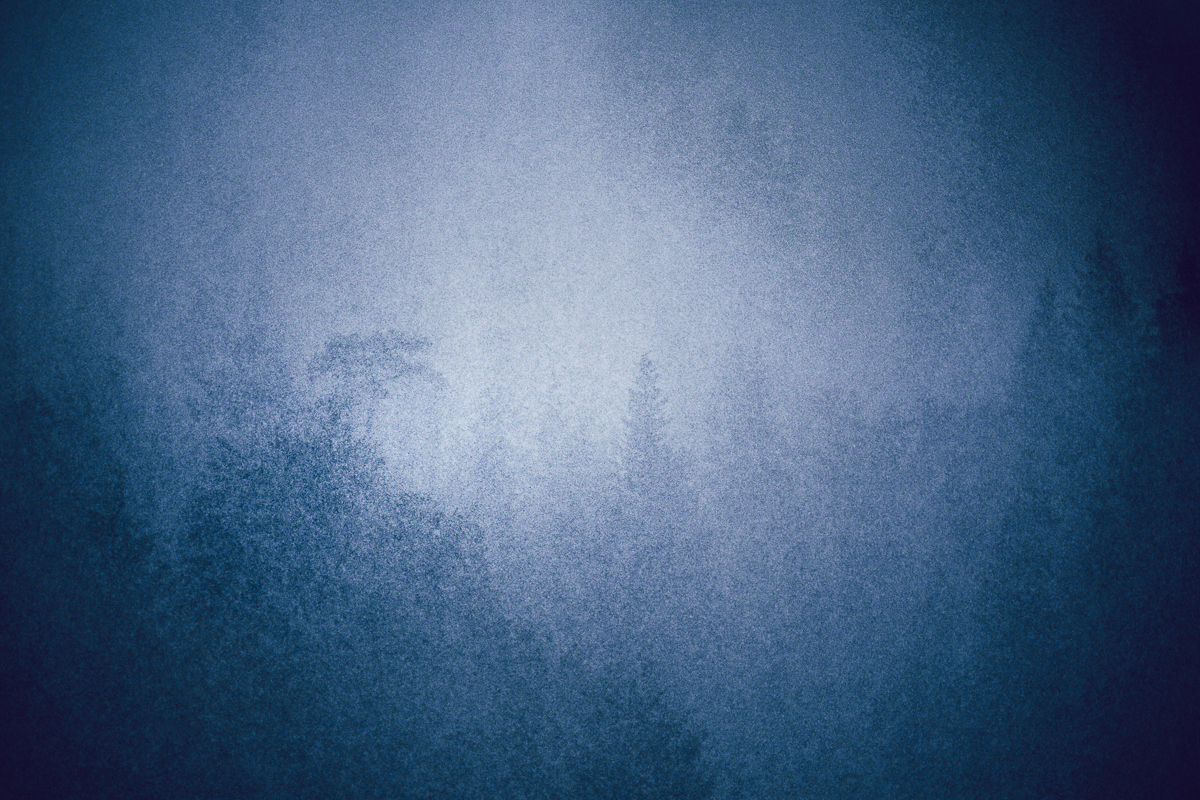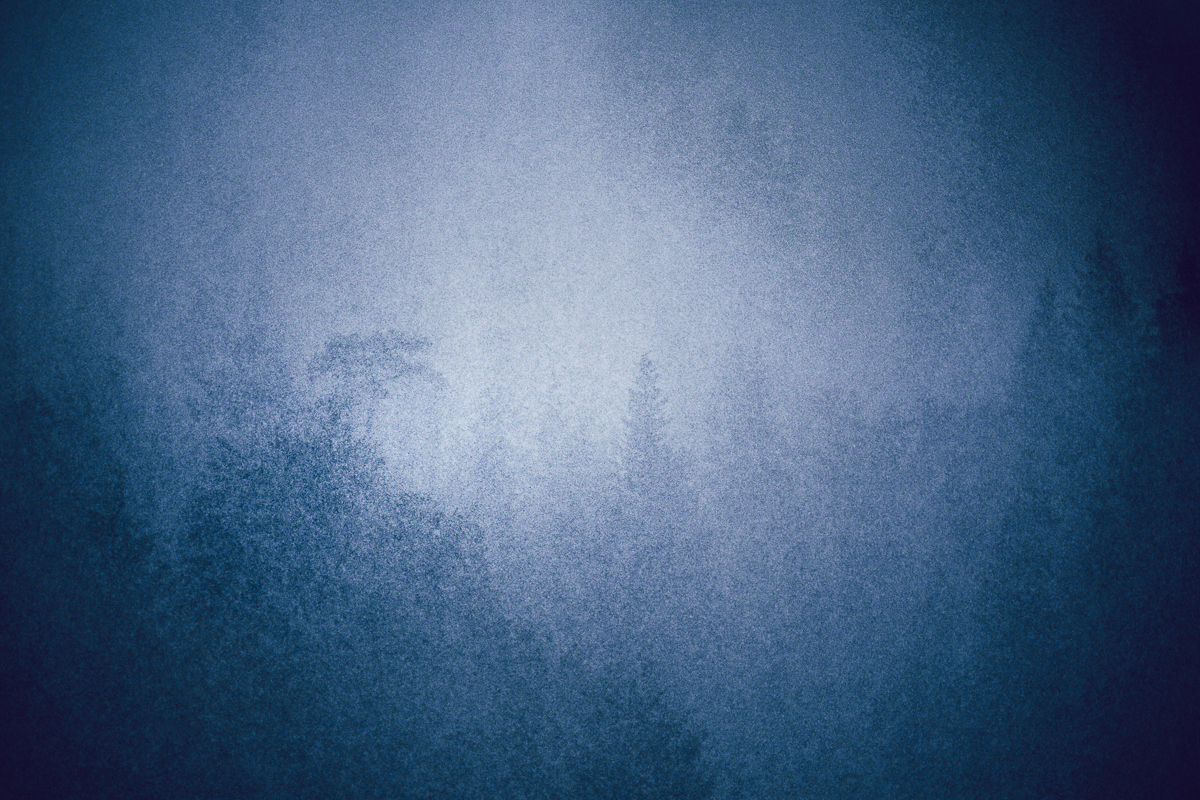
Je ne sais pas à quel moment exactement
Il s’est arrêté
De battre
Mon cœur.
Peut-être lorsque j’ai commencé à creuser le trou, j’avais supplié la terre d’être douce, et elle s’est ouverte facilement, comme une bouche aimante lors d’un baiser. Elle s’est ouverte miraculeusement, la terre dure et rocailleuse de chez nous. Et c’était bon de creuser encore et encore, j’aurais pu continuer ainsi toujours. Et ne plus voir le reste.
Le trou était bien trop grand pour le petit corps que j’ai déposé là. Je n’avais pas compris jusqu’à cet instant je crois, comme elle était devenue maigre, notre chatte, comme la maladie l’avait vidée et abîmée. Je l’ai couchée sur le lit d’herbes sauvages et de fleurs que j’avais installé au fond, je me suis accrochée à la lourde pelle, et j’ai sangloté longuement sous la pluie qui commençait à tomber. Peut-être est-ce là…
Ou bien déjà la veille au soir, quand nous avons été la récupérer dans la benne à ordures. Les premières chouettes, irréelles, filaient le crépuscule de leur cri mélodieux, tandis que nous fouillions chaque poubelle. Je ne leur en veux pas, aux pauvres bougres qui l’ont jetée là. La mort de nos jours est tellement couverte de fards, qu’elle peut faire peur quand on la croise, simple et nue, couchée dans la cabane des enfants, à côté de la balançoire.
Nous l’avons trouvée, notre trésor, dans les détritus. Belle encore sous l’odeur qui me soulevait le cœur. Oui, peut-être est-ce là… Elle nous attendait depuis 36 heures. Et nous attendions qu’elle revienne miauler à la fenêtre du salon.
Nous l’avons veillée sous la demie lune qui entrebâillait le châle des nuages, nous avons écouté le vent souffler doucement sur son poil éteint, la pluie laver son corps osseux. J’ai appelé les bénédictions des éléments sur elle, et demandé à la Grande Mère de la recevoir. Je ne sais plus s’il battait encore, mon cœur, sous mes chants et mes prières.
Je ne sais plus mais les étoiles
Parfois
Venaient s’échouer aux rives noires du ciel.
Lorsque tout fut fini, c’est là que la douleur a ouvert sa grande gueule béante et j’ai plongé toute entière dans le puits sans fond des « si seulement » et des « pourquoi ».
Pourquoi est-elle allée mourir là-bas loin de nous ? Pourquoi n’ai-je pas senti que le moment était arrivé ? Si seulement ils étaient venus toquer à notre porte, ceux qui l’ont vue dans la cabane des voisins, agonisante, mais vivante encore. Si seulement je l’avais cherchée ce soir là… Elle serait morte dans nos bras, au creux de la maison de bois blond, j’aurais allumé un feu pour elle, je l’aurais couchée sur sa couverture préférée. Elle aurait senti, sous la terrible solitude de sa maladie incurable, comme nous l’aimions encore. Pourquoi ?
Je repasse en boucle tout ce que je n’ai pas fait, tout ce que je n’ai pas vu. Et je le sens se broyer, là sous mes côtes, mon cœur écrasé de reproches, mon cœur en miettes de regrets. Je voulais une belle mort pour elle, une mort dorée de tendre bougies, une mort chaude bercée de caresses. Parce que la vie, parfois, est une ogresse qui nous arrache tout, je voulais pour elle une mort comme une fête.
Elle n’avait que 4 ans, notre petite chatte, et la maladie était déjà là, tapie sous la lumière de son poil de chaton, quand nous l’avions accueillie chez nous. Ironie du sort, c’est un coronavirus qui a, lentement, impitoyablement, ravagé son corps et mangé sa lumière, comme cet autre qui ouvre le chaos dans notre monde en éteignant nos rêves.
On ne peut pas contrôler la vie, souffle mon amoureux dans mes cheveux mouillés de larmes. La mort non plus tu sais. Je sais. Pas de fête au coin du feu. Juste la solitude de la petite cabane et la benne à ordures.
Alors voilà. Quand il me dit, veux-tu que nous sortions un peu, je réponds oui pourquoi pas, sourire vide et yeux vagues, je vois la chatte en boule sur chaque rebord de fenêtre, dans chaque pli de couverture. Sur les plateaux, là-haut ? Oui oui.
La petite tombe est là dehors, sous ses mandalas de fleurs, puis les paysages somptueux jetés absurdement contre les vitres de la voiture, oui oui, les forêts familières que je ne reconnais plus, la marche coupée, aveugle, sans chansons ni parfums, mes jambes automates, oui oui. Je pourrais monter, encore et encore, infatigable comme la pelle hier matin dans la terre docile. Et puis…
Il a commencé à neiger. De gros flocons cotonneux qui se posent sur les feuilles encore vertes des hêtres et brouillent les capuches pointues des sapins. Qui m’attrapent par surprise au fond de mon chagrin. C’est beau, la mélodie feutrée de la neige, les flocons fondus à mes doigts. C’est beau ces brumes qui gambadent aux crêtes en faisant danser leurs queues pâles.
C’est là je crois
Sous les écharpes blancs murmures
Enroulées aux ronrons des arbres
Que je l’ai senti à nouveau
Tout doucement
Battre
Mon cœur.











 Etre photographe, c’est s’intéresser aussi au sens profond de cet art qu’on a fait sien. Savoir pourquoi on fait les choses, la plupart du temps cela aide à mieux les faire! Par certains côtés, la photographie est une forme de témoignage, une manière d’attraper un instant éphémère, d’en fixer la réalité et l’intensité. L’instant passe, mais l’image reste et parle. Elle est la gardienne de nos mémoires et de nos moments de vie. L’éclaircie qui perce la brume, les premiers sourires de notre enfant, et aussi la douleur de la guerre, ou celle d’une forêt en flammes. Mais la photographie est plus que cela: c’est une forme de créativité, et créer c’est transformer le réel, notre regard a ce pouvoir là. Et il suffit de regarder les photos des uns et des autres en stage, les différentes restitutions du même moment que nous avons tous partagé, pour voir que chaque image est un acte de création.
Etre photographe, c’est s’intéresser aussi au sens profond de cet art qu’on a fait sien. Savoir pourquoi on fait les choses, la plupart du temps cela aide à mieux les faire! Par certains côtés, la photographie est une forme de témoignage, une manière d’attraper un instant éphémère, d’en fixer la réalité et l’intensité. L’instant passe, mais l’image reste et parle. Elle est la gardienne de nos mémoires et de nos moments de vie. L’éclaircie qui perce la brume, les premiers sourires de notre enfant, et aussi la douleur de la guerre, ou celle d’une forêt en flammes. Mais la photographie est plus que cela: c’est une forme de créativité, et créer c’est transformer le réel, notre regard a ce pouvoir là. Et il suffit de regarder les photos des uns et des autres en stage, les différentes restitutions du même moment que nous avons tous partagé, pour voir que chaque image est un acte de création.